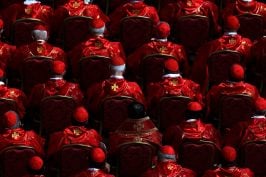Éloignement des étrangers par les États-Unis : Trump se conforme-t-il au droit ?
La politique d’éloignement des étrangers, mise en place par les États-Unis depuis le début du second mandat de Donald Trump, défraie l’actualité depuis plusieurs mois. Les cours de justice américaines, la Cour Suprême y compris, ont rendu de nombreuses décisions en la matière sans parvenir, semble-t-il, à restreindre ce que l’anglais qualifie de « deportations ». Que dit le droit, international et américain, en la matière ?

Par Thibaut Fleury Graff, Professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas, Directeur du Master Droit international public
Quelle est la politique mise en œuvre par le Président des États-Unis Donald Trump en matière de migrations depuis son arrivée au pouvoir ?
La perception trumpiste de la question des migrations est résumée dans un document tout en nuances, sobrement intitulé « Protecting the american people against invasion ». Publiée dès le 20 janvier 2025, le jour même de son investiture, cette ordonnance d’une vingtaine d’articles dénonce la politique laxiste de l’administration précédente et qualifie de « menace pour la sécurité nationale et l’ordre public » « beaucoup » (« many ») des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. « Les autres » (« others ») seraient quant à eux impliqués dans des « activités hostiles » tels que l’« l’espionnage, l’espionnage économique, et la préparation d’activités destinées à terroriser » la population (« terror-related activities »).
Sorte de « circulaire » fixant aux responsables des agences fédérales concernées (principalement la U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE et la U.S. Customs and Border Portection, CBP) des priorités en matière d’immigration et d’éloignement, le document insiste surtout sur l’application d’un certain nombre d’articles spécifiques du Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1101 sq.) (INA) – tout particulièrement ceux qui permettent de faciliter les éloignements, notamment par la détention des étrangers concernés et la négociation diplomatique avec les États de renvois. Le même document insiste encore sur l’application de sanctions aux étrangers récalcitrants ainsi qu’aux États fédérés qui rechigneraient à assister les agences fédérales en matière d’éloignement, et ce en les privant de subventions.
La décision de l’administration Trump de recourir à une loi de 1789, l’Alien Enemies Act (50 U.S.C. 21 sq.) a également été beaucoup commentée. Elle est mobilisée, en l’espèce, non pas à l’égard de tous les étrangers – qui dépendent de l’INA – mais uniquement, à ce stade, à l’égard des membres du Tren de Aragua, une organisation criminelle transnationale ayant ses racines au Venezuela, bien connue pour l’extrême violence de ses membres, y compris en territoire américain : des sanctions ont été adoptées à son encontre dès Juillet 2024 sous la présidence Biden. L’invocation de l’Alien Enemies Act permet à l’administration actuelle – selon son interprétation à tout le moins – d’éloigner manu militari, sans recours possible, les citoyens « mâles d’au moins 14 ans » d’une « nation ennemie ». Une telle Nation peut être qualifiée ainsi, selon le même texte, si elle est en guerre déclarée contre les États-Unis ou si elle a envahi – ou menace ou tente de le faire – le territoire de ces derniers.
Les chiffres des éloignements effectivement réalisés sur la base de ces politiques demeurent cependant comparables à ceux de l’administration Biden : 12 000 étrangers avaient été éloignés en février 2024, contre 11 000 seulement en février 2025. Les arrestations ont bondi, mais il paraît peu probable qu’elles permettent d’éloigner l’ensemble des personnes arrêtées. Aussi les éloignements ne devraient-ils pas atteindre le chiffre d’un million par an promis par le nouveau Président américain.
Que dit le droit américain en matière d’éloignement et la politique de Donald Trump respecte-t-elle ce droit ?
Le système juridique américain en matière d’éloignement des étrangers, comme souvent dans les pays occidentaux, est particulièrement complexe. Il est néanmoins possible d’affirmer que, sur le fondement de l’INA, trois catégories d’étrangers peuvent être éloignés : ceux qui sont entrés irrégulièrement sur le territoire américain, ceux qui sont entrés régulièrement mais s’y sont ensuite maintenus sans titre, ou encore ceux qui, quoique présents régulièrement aux États-Unis, ont commis certains crimes ou menacent la politique étrangère américaine (c’est sur ce dernier fondement qu’avait été arrêté, dans une affaire très médiatisée, un étudiant de la Colombia University, motif pris, notamment, de son activisme pro-palestinien, et ce alors qu’il se trouvait en situation régulière et en cours de naturalisation). Ce dernier point mis à part, ce schéma est globalement identique à celui qui existe en France par exemple (voir en ce sens les Livres VI et VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, CESEDA), y compris quant à la possibilité de recourir à des éloignements en urgence pour les étrangers présentant une menace spécifique pour l’État.
La politique actuelle des États-Unis s’inscrit dans ce cadre juridique, dont elle exploite cependant spécifiquement et particulièrement certaines dispositions. Comme souvent en matière de droit des étrangers, la mise en œuvre des règles juridiques repose sur des priorités politiques fixées par le pouvoir exécutif. Le Président américain a mis l’accent dès le premier jour de son mandat sur l’exploitation de toutes les possibilités du cadre juridique, et fortement incité les agences fédérales compétentes à procéder à des arrestations d’étrangers en situation irrégulière – y compris, en revenant pour cela sur une pratique remontant aux débuts des années 2010, dans les écoles, les hôpitaux et les églises – et à recourir aux procédures d’éloignement en urgence absolue, lesquelles ont l’ « avantage » de priver les étrangers concernés d’un droit de recours suspensif de leur éloignement.
C’est sur ce point – la possibilité d’un recours effectif – que la politique actuelle est certainement la plus en délicatesse avec le droit américain, lequel protège, au niveau constitutionnel, ce droit de recours : c’est le fameux « right of habeas corpus », qui confère aux personnes détenues le droit de contester leur détention et d’en être libérées si leur détention est illégale. La Cour Suprême en a rappelé l’importance récemment : si elle a reconnu début Avril 2025 que l’Alien Enemies Act pouvait servir de fondement à l’éloignement d’étrangers « ennemis », elle a néanmoins considéré, quelques jours plus tard, que ces étrangers ne pouvaient être privés du droit de contester en justice leur éloignement sur ce fondement. En réponse, l’administration américaine réfléchit à la suppression de ce droit, ce qui serait une révolution juridique dans un monde anglo-saxon où le « writ of habeas » constitue la base juridique et philosophique séculaire du libéralisme moderne.
Qu’en est-il du droit international ?
Ce droit au recours, de même qu’un certain nombre de garanties en matière d’éloignement des étrangers, est, en toute hypothèse, protégé par le droit international. Comme l’a rappelé fin avril un groupe d’experts de l’ONU, le droit de n’être pas éloigné vers un pays où il existe un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants est protégé par l’article 3 de la Convention contre la torture de 1984, que les États-Unis ont ratifiée. Droit absolu, l’interdiction de la torture et de l’éloignement dans l’hypothèse où un le risque d’un tel traitement est constitué fait partie aujourd’hui du droit coutumier et impératif : aucun État ne peut y déroger (voir par ex. CIJ, Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), 2012, §99).
Ce droit contraint les États à examiner de manière individuelle la situation des étrangers qu’il s’apprête à éloigner, afin de s’assurer que le risque de tels traitements n’est pas constitué. Si tel est le cas, alors l’étranger concerné doit pouvoir se maintenir sur le territoire national, ou être éloigné vers un autre État.
Or, les éloignements d’étrangers par les États-Unis, en particulier vers le Salvador, de manière collective et sans possibilité de recours, viole certainement cette obligation internationale, d’autant que la situation dans les prisons salvadoriennes, où ces étrangers sont détenus à leur arrivée, est particulièrement délétère.
Sans doute l’ensemble de ces contraintes finissent-elles par peser sur l’administration fédérale actuelle : il y a quelques jours, le Président américain a annoncé la mise en place d’un programme incitant les étrangers en situation irrégulière à rentrer de leur propre initiative dans leur pays d’origine, et ce, contre une aide de 1000 $, largement insuffisante, mais qui témoigne d’un infléchissement certain après 100 jours de difficultés pratiques et juridiques.