Dieselgate : les constructeurs automobiles devant la justice britannique
Le 13 octobre 2025 a débuté à la Haute cour de Londres le procès, prévu pour durer trois mois, pour décider de la responsabilité de plusieurs constructeurs automobiles dans l’affaire du trucage des logiciels de mesure de la pollution émise par les voitures diesel. Avec 1,6 million de plaignants et plus de 6 milliards de livres de dommages-intérêts réclamés, il s’agit de la plus vaste action de groupe jamais engagée au Royaume-Uni.
Publié le
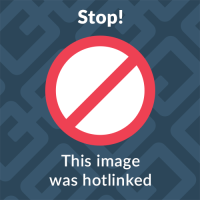
Par Simon Taylor, Professeur à l’Université Paris Nanterre
Que reproche-t-on aux constructeurs automobiles ?
Au cœur du dossier, une accusation grave : celle d’avoir manipulé les tests d’émissions polluantes. Mercedes, Ford, Renault, Nissan, Peugeot et Citroën sont notamment visés par les plaignants, propriétaires ou anciens propriétaires de véhicules concernés, pour avoir équipé certains véhicules de logiciels dits « defeat devices ». Ces programmes permettaient de fausser les mesures d’émission d’oxydes d’azote (NOₓ) afin de satisfaire les seuils réglementaires lors des tests officiels, tout en rejetant des niveaux bien supérieurs lors d’une utilisation réelle.
Le procès qui s’est ouvert doit donc déterminer si ces dispositifs ont effectivement été installés, et s’ils constituaient des violations de la réglementation européenne sur les émissions. Si la violation est établie, plusieurs questions juridiques se poseront : la tromperie sur les émissions équivaut-elle à une rupture des obligations contractuelles de qualité et de conformité des véhicules vendus ? Peut-elle engager la responsabilité civile des constructeurs pour violation d’une obligation légale, notamment la réglementation sur les émissions ? Et s’agit-il d’une pratique déloyale ou de tromperie ?
Quelle procédure pour gérer une action à 1,6 millions de plaignants ?
L’ampleur du contentieux donne le vertige : 1,6 millions de plaignants, représentés par vingt cabinets d’avocats. Pour gérer la masse de plaignants, la justice britannique a recours à un mécanisme spécifique : le Group Litigation Order (GLO). Treize actions collectives ont été enregistrées, dont l’une, dirigée contre Mercedes, a été désignée comme affaire pilote.
Le GLO, en droit anglais, permet de regrouper des actions partageant des questions communes, tout en permettant des divergences sur d’autres aspects de l’affaire. Le système repose sur un registre de plaignants : tous ceux qui y sont inscrits seront liés par la décision finale. Ce mécanisme, fondé sur une adhésion volontaire des plaignants, est lourd à administrer à une telle échelle.
Pour alléger la charge procédurale, les tribunaux britanniques recourent à des « test claims », des demandes représentatives portant sur les questions centrales du litige. Les conclusions du juge à leur sujet s’appliqueront ensuite à l’ensemble des demandeurs. Malgré ces efforts de rationalisation, les coûts restent colossaux : même après une réduction drastique ordonnée par la juge Cockerill, en charge de la gestion de l’affaire, les frais de justice devraient atteindre environ 237 millions de livres.
Quels enjeux pour ce procès aux dimensions inédites ?
Le procès ouvert en octobre est le deuxième acte d’une trilogie judiciaire. Le premier, en 2024, avait établi que les juges britanniques ne sont pas liés par les conclusions des autorités réglementaires allemandes sur la conformité des véhicules. Le troisième, prévu pour octobre 2026, devra trancher les questions de causalité — c’est-à-dire le lien entre les infractions présumées et les préjudices subis — ainsi que le calcul des dommages-intérêts.
Cette nouvelle étape est donc cruciale, sans pour autant être la dernière. Elle s’inscrit dans le prolongement du « Dieselgate », révélé en 2015, qui avait déjà coûté quelque 30 milliards d’euros à Volkswagen dans le monde. Au Royaume-Uni, le constructeur allemand avait accepté en 2022 de verser 193 millions de livres à environ 91 000 propriétaires, tout en niant toute responsabilité.
Les autres constructeurs automobiles risquent aujourd’hui de subir le même sort. En cas de condamnation, les dommages-intérêts pourraient atteindre des montants vertigineux et ouvrir la voie à d’autres actions collectives en Europe. L’impact sur leur réputation serait tout aussi lourd : la confiance du public dans les promesses écologiques des grands constructeurs en sortirait durablement entamée.
Mais cette affaire est aussi un test pour la justice britannique. Elle met à l’épreuve la capacité du système des actions de groupe à gérer un contentieux d’une telle ampleur, ainsi que le pouvoir du juge de contrôler les coûts dans un système où la collecte des preuves incombe largement aux parties. En imposant un plafond de dépenses bien inférieur aux budgets initiaux, la Haute Cour a envoyé un signal clair : les dépens doivent rester à un niveau raisonnable, même dans les procès les plus complexes.
Enfin, au-delà des enjeux financiers et procéduraux, l’affaire pose une question de santé publique. Selon une étude publiée par l’ONG environnementale ClientEarth, les dépassements illégaux d’émissions d’oxydes d’azote depuis 2009 seraient responsables de 205 000 morts prématurées et 152 000 cas d’asthme infantile dans l’Union européenne et au Royaume-Uni d’ici 2040 — un coût social et économique estimé à 1 200 milliards d’euros.
Si la procédure engagée devant la Haute Cour de Londres contribue à renforcer la transparence sur les émissions toxiques et la responsabilité des constructeurs, nous serons tous gagnants.


