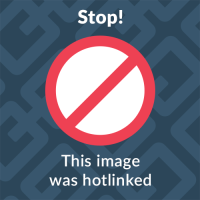Loi Duplomb : comment examiner une pétition au Parlement ?
Le 17 septembre 2025, la Commission des affaires économiques a décidé, sur proposition de la rapporteure, d’examiner la pétition intitulée « Non à la Loi Duplomb » ayant récolté sur la plateforme de l’Assemblée nationale plus de deux millions de signatures. Cette pétition fera l’objet d’une discussion au Parlement.
Publié le | Modifié le

Par Philippe Blachèr, Professeur de droit public à l’université Jean MOULIN Lyon 3
L’examen d’une pétition par une commission du Parlement est-elle inédite ?
Si le Parlement vote la loi, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques (article 24 de la Constitution), l’examen d’une pétition est rare. Depuis sa rénovation par la réforme du Règlement de l’Assemblée nationale (article 148 à 151 du RAN) du 4 juin 2019, un seul précédent peut être mentionné : la Commission des affaires sociales a pris la décision d’examiner une pétition déposée sur la plateforme dédiée sur le site internet de l’Assemblée nationale le 12 juillet 2023 (« Allongement de la durée du congé maternité », ayant recueilli 44 903 signatures).
À lire aussi : Loi Duplomb : un souffle nouveau pour le droit de pétition
Les débats tenus en Commission sur la pétition sont publiés dans un bref rapport fait en application de l’article 148 du RAN, avec un avant-propos du rapporteur et le texte de la pétition. Ce rapport est publié sur la page internet de la Commission des affaires sociales (rapport au nom de la Commission des affaires sociales sur la pétition n° 1067 du 20 octobre 2022, « Allongement de la durée du congé maternité »).
Les dispositions du RAN envisagent deux hypothèses pour valoriser les pétitions qui obtiennent un nombre très élevé de signatures. Tout d’abord : « Les pétitions sont mises en ligne lorsqu’elles sont signées par plus de 100 000 pétitionnaires » (art.148-1). A ce jour, seuls quatre textes ont franchi ce seuil (pétition « Pour la dissolution de la BRAV-M », classée par la Commission des Lois en 2023 ; pétition « Mehdi Bassit : pour que les réseaux ne soient plus une arme », renvoyée à la Commission des affaires économique ; « Demande de destitution du Président de la République en vertu de l’article 68 de la Constitution », renvoyée à la Commission des Lois en avril 2026 ; et enfin, « Non à la loi Duplomb » renvoyée en Commission des affaires économiques). Ensuite, le RAN prévoit la possibilité d’organiser à l’Assemblée nationale « un débat sur rapport relatif à une pétition signée par plus de 500 000 pétitionnaires » domiciliés dans 30 départements (art.148-6 RAN).
Avec plus de 2 100 000 signatures, la pétition « Non à la loi Duplomb », déposée par une étudiante en Master en juillet 2025, ne pouvait pas laisser les parlementaires inactifs. La Commission des affaires économiques a donc décidé, à l’unanimité, sur la base du rapport présenté par Madame la députée Hélène Laporte (favorable à l’examen), d’examiner le texte lors de la séance du 17 septembre 2025.
De manière inédite, l’Assemblée nationale pourrait engager un débat en séance publique sur une pétition citoyenne (si la Conférence des présidents autorise son inscription à l’ordre du jour).
Selon quelles modalités s’organisera la procédure d’examen de la pétition au Parlement ?
Comment discuter d’une pétition au Parlement ? Il n’est pas possible de transposer les méthodes classiques de délibération des propositions de loi (discussion-amendements-vote) car une pétition n’a ni la nature ni la portée d’un texte législatif. En particulier, elle ne fera pas l’objet d’un vote : on discute (point déjà important puisqu’il remet dans l’agenda politique la question de la portée des dispositions de la loi, dont la disposition centrale a été censurée par le Conseil constitutionnel – décision n°2025-891 DC, du 7 août 2025) mais on ne décide de rien (l’examen ne peut pas déboucher sur une nouvelle loi).
Pour mener à bien cette procédure, le bureau de la Commission des affaires économiques s’est donc réuni le mardi 23 septembre 2025 afin de tenter de cadrer les étapes de l’examen de la pétition. A priori aucun calendrier n’a été établi et aucun rapporteur n’a encore été désigné. Toutefois, il a été décidé d’instituer prochainement un binôme – un rapporteur favorable et un rapporteur défavorable – afin de mettre en perspective les arguments au soutien et contre la Loi Duplomb.
La prochaine étape devant la Commission des affaires économiques sera celle de la préparation des discussions et du court rapport. Ce rapport est tenu de reproduire le texte de la pétition et les comptes-rendus des débats menés devant la Commission lors de la séance du 17 septembre dernier. Des auditions peuvent aussi être organisées en associant des ministres ou les premiers signataires de la pétition.
Une dernière étape pourrait se tenir en séance publique sous réserve d’une demande par la Présidente de la Commission des affaires économiques et, surtout, après accord de la Conférence des présidents pour inscrire le débat à l’ordre du jour. Ce cas de figure est inédit. La procédure est à construire et l’actualité parlementaire incite à ne pas percevoir le sujet comme étant prioritaire dans l’agenda des députés. Un débat s’engagerait dans l’hémicycle après lecture du travail de la Commission par les rapporteurs. Et au final, il n’y aurait aucun vote.
L’examen en séance publique serait l’occasion d’évoquer à nouveau les arguments des défenseurs et des opposants à la Loi Duplomb. On peut d’ores et déjà s’interroger sur les risques d’un déplacement des discussions qui glisseront inévitablement du contenu de la pétition vers la Loi Duplomb. A moins que les députés ne décident de débattre aussi sur le sort des pétitions : ne sont-elles que des ornements destinés à publier les doléances ayant reçu un important soutien populaire ou bien peut-on en faire autre chose ? N’y-a-t-il pas une occasion pour les députés d’imaginer une portée plus effective du droit de pétition ?
A quoi peut servir cet examen ? Peut-on y déceler une forme d’initiative législative populaire ?
Le dispositif des pétitions en ligne pourrait présenter une certaine proximité avec la notion d’initiative législative populaire dans la mesure où il porte sur une demande populaire (soutenue par des milliers de personnes) afin de proposer une réforme du droit (de la loi) dans l’intérêt général. Ces éléments correspondent aux critères de la définition des instruments d’initiative populaire que l’on recense dans certaines démocraties (voir par ex. pour l’Allemagne, Stéphane Schott, L’initiative populaire dans les états fédérés allemands. Contribution à la connaissance d’une institution démocratique, LGDJ, bibliothèque constitutionnelle et de science politique, tome 139, 2012). Mais il manque au mécanisme du droit de pétition des caractéristiques pour prétendre être rangé dans la catégorie des formes d’initiative législative populaire.
Premièrement, la signature d’une pétition n’est pas réservée aux citoyens. Les pétitions ont vocation à recueillir les signatures des personnes de nationalité françaises ou résidant régulièrement en France : les signataires ne sont donc pas forcément des électeurs ou des citoyens, au sens du droit constitutionnel. Les conditions générales d’utilisation du site internet ouvrent l’accès à la signature aux personnes identifiables par FranceConnect qui est un service de la direction interministérielle du numérique permettant de recevoir les signatures d’un particulier, français ou non, électeur ou non, disposant d’une identification par exemple auprès de l’administration fiscale ou de l’assurance maladie. A l’inverse, lorsqu’elle est reconnue par le droit constitutionnel d’un Etat (ce qui est le cas notamment en Italie, en Espagne), l’initiative législative populaire se présente comme un mécanisme initié par les citoyens. A titre d’exemple, l’article 87, alinéa 3, de la Constitution de 1978 du Royaume d’Espagne prévoit l’initiative populaire en matière de loi (à l’exclusion de certaines matières comme les lois organiques, fiscales, à caractère international ou en lien avec les prérogatives du droit de grâce). La loi organique 3/84 réserve aux citoyens ayant la qualité d’électeurs aux élections générales – donc aux nationaux – le droit d’y participer.
Deuxièmement, une initiative populaire propose une loi ; une pétition s’inscrit plutôt dans une perspective plus large : elle réclame, interpelle, sollicite, propose, vise à contrôler… Le cas de la présente pétition confirme que l’initiative n’a pas pour objectif d’initier un texte (que le Parlement pourrait, ensuite, inscrire à l’ordre du jour pour l’examen selon la procédure parlementaire applicable pour les propositions de loi). La pétition déposée en juillet 2025 vise à solliciter l’abrogation d’une loi fraichement votée et à marquer une inquiétude d’une partie (non négligeable) de l’opinion publique sur les risques que les dispositions de la loi font peser sur la santé publique et l’environnement. Un rapprochement avec l’usage du RIP s’agissant de la Loi ADP ou de la réforme des retraites s’impose. Une fois de plus, le mécanisme de participation ne sert pas à présenter pour la discussion une nouvelle loi mais à dénoncer une loi votée très récemment (dans les deux exemples rappelés, le déclenchement du RIP visait une loi votée mais non promulguée). Dans ce cas, les instruments de participation citoyenne sont mobilisés contre le travail parlementaire, ce qui – il faut le reconnaitre – n’est ni logique (la participation citoyenne peut/doit-elle être pensée contre la représentation parlementaire ?) ni opportun (puisque, dans une telle configuration, l’initiative ne peut conduire qu’à la rédaction du court rapport et susciter des désillusions).
Il reste que le succès populaire de la présente pétition témoigne d’un engouement des citoyens pour la chose publique et pour la protection de la santé publique. A l’heure où les enquêtes d’opinion dénoncent la défiance des électeurs vis-à-vis de la politique, il convient peut-être de relativiser le pessimisme ambiant et de continuer à s’intéresser au sort de cette pétition dans les prochaines semaines.