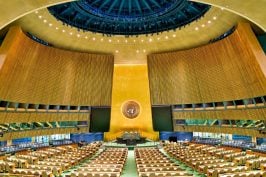Accord UE-Mercosur : le moment de vérité approche
Le collège des commissaires européens a adopté une série de propositions relatives à la signature de l’accord négocié depuis la fin des années 2000 entre l’Union européenne, le Mercosur et leurs États membres respectifs. Alors que la Confédération paysanne appelle à manifester à Paris le 14 octobre pour « stopper l’accord de libre-échange UE-Mercosur », quelles sont les prochaines étapes ?
Publié le

Par Alan Hervé, Professeur de droit public à Sciences Po Rennes
Quels objectifs poursuit l’accord UE-Mercosur ?
Les relations entre l’Union européenne et les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) sont anciennes et sont encore régies par un accord-cadre de coopération, largement obsolète, signé en 1995. Dès 1999, le Conseil a autorisé la Commission européenne à négocier un nouvel accord d’association plus ambitieux incluant une zone de libre-échange. Les négociations proprement dites ont duré près de 25 ans et ont connu de multiples rebondissements. Celles portant sur le volet commercial de l’accord ont été finalisées en juin 2019 tandis que celles intéressant les aspects politiques et de coopération se sont achevées un an plus tard.
En 2023 et 2024, sous la pression de plusieurs États membres et d’une partie du Parlement européen, des négociations supplémentaires ont été consacrées au renforcement des liens entre commerce et développement durable et à la possibilité pour les pays du Mercosur d’obtenir davantage de souplesse dans leurs engagements en matière de libéralisation. Ce n’est qu’en décembre 2024, lors du sommet de Montevideo, en Uruguay, que les négociateurs se sont mis d’accord sur l’ensemble des engagements conventionnels. Jusqu’à début septembre 2025, seule la partie principale de l’accord commercial avait été rendue publique. On connaît désormais le contenu des engagements politiques qui vise, pour l’essentiel, à renforcer la coopération et le cadre institutionnel du dialogue politique, et le détail des concessions commerciales. L’ensemble de ces dispositions s’étend sur plusieurs centaines de pages.
Que contiennent les clauses de sauvegarde ajoutées par la Commission européenne ?
Précisons, tout d’abord, que la possibilité de recourir à des clauses de sauvegarde n’a rien de très original. On la retrouve même dans la plupart des accords de libre-échange. En l’occurrence, l’accord commercial UE-Mercosur prévoit, en plus des mesures de sauvegarde dite globales, susceptibles d’être appliquées conformément aux règles de l’OMC à l’égard de tous les pays tiers, le possible recours à des mesures de sauvegarde bilatérale, qui couvrent l’ensemble des marchandises libéralisées, y compris les produits agricoles soumis à des contingents tarifaires comme celui de la viande bovine. Ces sauvegardes bilatérales permettront à l’UE et aux pays du Mercosur d’imposer des mesures temporaires afin de réagir à une hausse des importations dans des quantités telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à leur branche de production nationale. Ces mesures consisteront, concrètement, en une hausse des droits de douane limitée qui ne peut en principe excéder le niveau maximal autorisé au titre des accords de l’OMC. Provisoires, ces mesures ne s’appliqueront que pour la période nécessaire et pas, en principe, pour plus de deux ans. L’accord prévoit également la possibilité de recourir à des mesures de sauvegarde spécifiquement dédiées à la situation et au territoire des régions ultrapériphériques de l’UE, dont font partie les départements français ultramarins.
Quelles sont les prochaines étapes pour que cet accord puisse entrer en vigueur, et les probabilités d’y parvenir ?
Juridiquement, la situation est assez complexe. On recense en effet quatre propositions en date du 3 septembre, la Commission ayant choisi de soumettre deux accords distincts à la signature et à la conclusion du Conseil.
Le premier texte est intitulé « Accord intérimaire sur le commerce entre l’UE, le marché commun du sud (Mercosur) et ses quatre pays membres ». Cet accord intérimaire reprend les engagements de nature commerciale. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice (avis 2/15), la Commission considère que les matières couvertes par cet accord relèvent de la compétence exclusive de l’Union européenne. Cela justifie en particulier que l’accord puisse être signé et conclu par l’Union seule, sans ses propres États membres.
Le second accord est quant à lui intitulé « Accord de partenariat UE-Mercosur ». Ce texte reprend l’ensemble des dispositions commerciales issues de l’accord intérimaire. Il comprend en outre des dispositions institutionnelles qui créent des organes conjoints, de niveau politique mais aussi technique, destinés à assurer le suivi et la mise en œuvre des engagements. Les parties s’y engagent également à poursuivre un dialogue politique et une coopération sur des sujets d’intérêts commun (sécurité internationale, développement durable, partenariat social, économique et culturel…). L’accord de partenariat comporte encore des clauses dites essentielles, au sens de la Convention de Vienne sur le droit des traités, tels que le respect des principes démocratiques, des droits humains, des principes de l’État de droit et la non-prolifération des armes de destruction massive. Ces éléments sont assez classiques dans les accords externes de l’Union. S’y ajoute un élément novateur, à savoir l’obligation de rester partie à la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique et à l’accord de Paris. Le non-respect de ces différentes clauses pourrait justifier une suspension, voire une dénonciation de l’accord.
L’accord de partenariat devra cependant, à la différence de l’accord intérimaire, être conclu côté européen par l’Union et ses 27 États membres, ce qui signifie qu’il ne pourra entrer en vigueur qu’à la condition que ceux-ci acceptent unanimement de le ratifier conformément à leurs procédures constitutionnelles internes, faisant le plus souvent intervenir les parlements nationaux. La Commission aurait pu choisir de faire appliquer ce texte à titre provisoire, notamment ses dispositions en matière de commerce, comme c’est le cas du CETA depuis 2017. Elle a préféré une autre formule, à savoir proposer à la signature et à la conclusion l’Accord intérimaire sur le commerce, qui relève de la compétence de la seule Union. L’accord intérimaire expirera et sera remplacé par l’accord de partenariat dès l’entrée en vigueur de ce dernier, à la suite de sa ratification par toutes les parties.
La Commission a visiblement souhaité contourner deux critiques qui lui ont été faites à propos de la conclusion de l’accord UE-Mercosur : tout d’abord, celle d’une séparation du contenu politique et commercial de l’accord alors que ce texte a historiquement été négocié comme un ensemble interconnecté ; et celle, ensuite, d’un recours abusif au procédé de l’application provisoire en matière d’accord de libre-échange. Le dispositif proposé n’en demeure pas moins assez artificiel et masque difficilement le fait que ce qui compte le plus aux yeux de la Commission est à l’évidence une mise en application rapide de la libéralisation des échanges.
L’objectif est désormais d’obtenir la signature et la conclusion de ces textes, particulièrement celles de l’accord intérimaire. La balle est à présent dans le camp du Conseil, qui devra prochainement se prononcer pour décider la signature de ces accords, et du Parlement européen, dont l’approbation précèdera obligatoirement les décisions de conclusion par le Conseil, qui conditionneront l’entrée en vigueur de ces textes.
L’hypothèse d’une opposition à l’accord réunissant une minorité de blocage au Conseil, qui se déterminera à la majorité qualifiée, semble aujourd’hui s’éloigner. Le rejet de l’approbation par le Parlement paraît également moins probable compte tenu de l’évolution du contexte des relations commerciales internationales ces derniers mois. Avec une OMC très fragilisée, face à l’instabilité étatsunienne et à la menace chinoise, les Européens souhaitent en effet stabiliser leur relations commerciales et assurer leur accès au marché avec ce qui leur reste de « partenaires » sur la scène internationale. Ceci explique notamment l’évolution récente de la position du gouvernement français, désormais plus favorable à l’accord, même si cette dernière pourrait pâtir de l’instabilité politique que traverse nos institutions.