Quartiers de lutte contre la criminalité organisée : un nouveau régime carcéral à l’épreuve du droit
Les premiers transferts de détenus vers les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, créés par la loi de juin 2025 visant à « sortir la France du piège du narcotrafic », ont débuté. Ce régime carcéral soulève néanmoins plusieurs questions juridiques.
Publié le
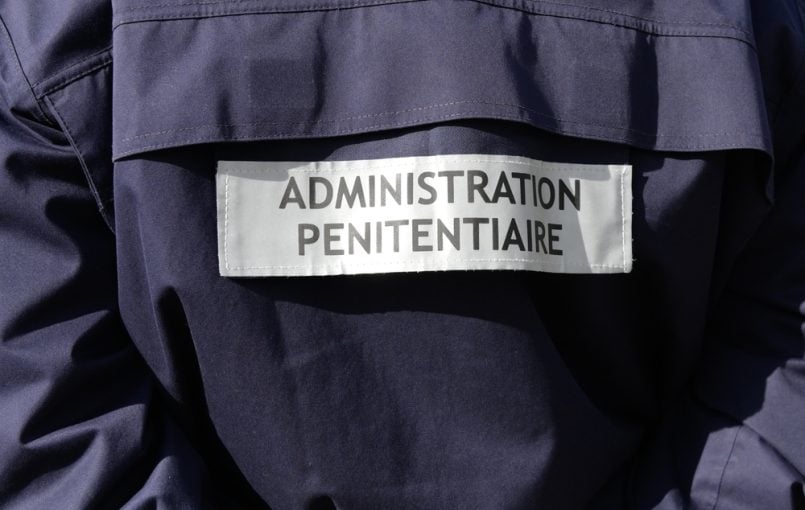
Par Joana Falxa, Maîtresse de conférences en Droit privé et sciences criminelles à Université de Pau et des Pays de l’Adour
Quel est le contexte de l’adoption de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic ?
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics alertent sur la capacité de certains trafiquants à poursuivre leurs activités depuis l’intérieur des établissements pénitentiaires. Les risques de corruption des personnels pénitentiaires, les pressions sur les familles et les difficultés de prise en charge de détenus considérés comme « hautement dangereux » ont conduit le ministre de la Justice à proposer un dispositif inédit, introduit par voie d’amendement gouvernemental. La loi du 13 juin 2025 crée ainsi des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, inspirés du modèle italien du carcere duro instauré contre la mafia dans les années 1990.
Ces quartiers visent à regrouper les individus les plus impliqués dans des réseaux criminels et à les couper strictement du monde extérieur. Deux établissements ont été désignés pour accueillir les premiers détenus : Vendin‑le‑Vieil et Condé‑sur‑Sarthe. Dès le 22 juillet, les premiers transferts ont eu lieu vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, donnant lieu à des contestations de la part de certains détenus et de leurs avocats. La création de quartiers spécialisés pour certains profils de détenus, en raison notamment de leur dangerosité, n’est pas nouvelle (comme en témoigne le sigle QHS, pour « quartier de haute sécurité », depuis longtemps abandonné). Dans cette nouvelle mouture toutefois, on observe quelques particularités liées à cette volonté d’isolement maximum du détenu.
Quelles sont les spécificités du nouveau régime de détention prévu en matière de criminalité organisée ?
Les quartiers de lutte contre la criminalité organisée instaurent un régime particulièrement restrictif. Leur finalité est double : empêcher toute communication avec l’extérieur susceptible de permettre la poursuite d’activités criminelles, et limiter les risques pour la sécurité des personnels. La mesure s’applique pour un an, renouvelable sans limitation de durée.
La décision de transfert ne peut être prise par le ministre de la Justice qu’à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne pourra être assistée de son avocat et présenter ses observations. Le ministre adopte sa décision après information du magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction pour les prévenus, mis en examen et accusés, ou sur avis du juge de l’application des peines pour les condamnés. Les détenus visés par une mesure de transfert vers l’un de ces quartiers devront saisir le juge administratif (en référé comme au fond) de toute éventuelle contestation.
Les conditions de détention comprennent des fouilles systématiques après tout contact physique avec des personnes extérieures non surveillées ; des visites uniquement dans des lieux avec dispositif de séparation physique, sauf exceptions pour les enfants mineurs ou en cas de circonstances familiales particulières ; l’absence d’accès aux unités de vie familiale (UVF) et aux parloirs familiaux ; d’importantes restrictions sur les appels téléphoniques, limités à deux heures consécutives deux fois par semaine ; un isolement accru et des contacts sociaux très limités.
Ce régime combine d’une certaine manière les logiques des anciens quartiers de haute sécurité (QHS) et du statut de détenu particulièrement signalé (DPS). Il ne se limite pas à un isolement administratif : il associe à la fois un profilage des détenus et un régime carcéral ultra‑sécurisé centré sur le lieu d’incarcération.
Quels sont les enjeux et risques de ce nouveau régime du point de vue des droits fondamentaux ?
Cette réforme soulève d’importantes interrogations du point de vue des droits fondamentaux. Si le modèle italien a été jugé globalement compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme (v. not. CEDH, gr. ch., 17 sept. 2009, Enea c/ Italie, req. 74912/01), des condamnations ont eu lieu dans des cas de vulnérabilité particulière ou de conditions de détention jugées inhumaines. Les principaux risques associés à un régime d’isolement strict tel que celui des quartiers de lutte contre la criminalité organisée ont trait à l’atteinte à la dignité des personnes détenues (art. 3 CEDH), en raison d’un isolement prolongé et de conditions de détention très strictes ; à l’atteinte à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH), en raison de la suppression quasi-totale des visites en contact direct et des visites en UVF ; et à l’atteinte au droit au procès équitable (art. 6 CEDH), par la fragilisation des droits de la défense : certains avocats ont ainsi pointé l’effectivité limitée des voies de recours contre les décisions de transfert vers ces quartiers.
Le Conseil d’État et le Défenseur des droits ont mis en garde contre l’absence de garanties suffisantes et rappelé que la justification d’un tel régime devait être circonstanciée : seule la nature exceptionnelle de la criminalité organisée peut justifier de telles restrictions dans une société démocratique.
Enfin, le Conseil constitutionnel a censuré certaines dispositions jugées excessives, notamment la généralisation de la visioconférence pour limiter les extractions et ainsi les opportunités de contact avec l’extérieur. Il a rappelé l’importance de la présentation physique devant le juge.
Ainsi, la création des quartiers de lutte contre la criminalité organisée trace un tournant dans la politique pénitentiaire française. Elle répond à des impératifs sécuritaires mais soulève des tensions majeures entre la nécessité de neutraliser les têtes de réseaux criminels et le respect des droits fondamentaux. Les prochains mois seront décisifs pour savoir si ce régime résistera au contrôle des juridictions nationales et européennes, notamment s’agissant de la proportionnalité de la mesure et des garanties offertes aux détenus concernés.


