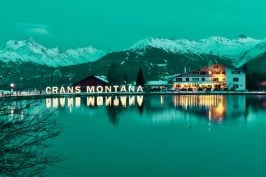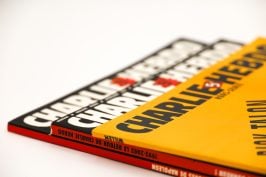Les violences à l’égard des magistrats en France : une menace pour l’État de droit ?
Les menaces qui ont été proférées contre une magistrate suite au procès concernant le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy nous invitent à questionner la montée des violences à l’égard des magistrats et son impact sur l’État de droit.
Publié le

Par Béatrice Brugère, magistrate et secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats-FO
Est-ce un fait nouveau, ou marginal ou assistons-nous à un phénomène de société, celui d’une violence décomplexée qui toucherait tous les représentants de l’État ?
Les agressions contre les magistrats en France semblent connaître une inquiétante progression : menaces de mort, intimidations, agressions physiques. Ces violences touchent désormais régulièrement juges et procureurs dans l’exercice de leurs fonctions et soulèvent des questions essentielles sur la protection de l’institution judiciaire et ses implications pour l’État de droit.
Si elles sont loin d’être nouvelles, elles prennent un visage nouveau ne serait-ce que par l’utilisation des réseaux sociaux et par un abaissement tangible du respect de l’autorité et de la règle. Les juges aux affaires familiales, les juges de la protection, les juges d’instruction et les procureurs apparaissent particulièrement exposés. On a connu de nombreuses affaires médiatisées qui ont donné lieu à des intimidations ou des violences contre les magistrats en France : l’affaire d’Outreau, dossier emblématique qui illustre sans doute le mieux les dérives possibles. Le juge d’instruction Fabrice Burgaud a fait l’objet d’un lynchage médiatique sans précédent : menaces de mort, campagnes de harcèlement, agressions verbales.
Nous avons connu également une vague d’intimidations et de menaces à l’encontre des magistrats antiterroristes qui ont constitué une cible privilégiée, notamment Marc Trévidic et Jean-Louis Bruguière, figures de la lutte antiterroriste. Ils ont longtemps bénéficié d’une protection rapprochée permanente en raison de menaces crédibles. Des réseaux djihadistes ont explicitement désigné des juges français comme cibles potentielles.
Les magistrats instruisant des dossiers liés au grand banditisme ou au trafic de drogue sont actuellement régulièrement menacés.
Concernant les affaires politiques et financières, certains magistrats ont dû faire face également à des menaces ou des campagnes de dénigrement virulentes sur les réseaux sociaux et dans certains médias (le juge Halphen et l’affaire Fillon).
Moins connues parce que peu médiatisées mais tout aussi graves, les affaires de violences conjugales et familiales donnent souvent lieu à des agressions physiques ou verbales comme cette affaire rapportée en 2019 où une juge aux affaires familiales a été agressée au couteau dans le Vaucluse par un homme mécontent d’une décision concernant la garde de ses enfants. D’autres magistrats ont été suivis jusqu’à leur domicile ou ont reçu des menaces de mort de parents en conflit.
Les affaires liées aux émeutes urbaines ont dans certains territoires marqués par la délinquance, entraîné à l’égard de magistrats identifiés, des menaces pour leurs décisions jugées trop sévères. Des cas de dégradations de véhicules personnels et de menaces indirectes transmises via des détenus ont été signalés. Il en a été de même suite à la crise des Gilets jaunes pour plusieurs procureurs et juges ayant traité des dossiers liés aux manifestations, victimes de campagnes d’intimidation sur Internet, avec diffusion de leurs coordonnées personnelles et appels à manifester devant leur domicile.
Peut-on alors parler, face à cette ambiance délétère, d’un péril pour la démocratie et l’État de droit ?
Ces exemples démontrent que les violences contre les magistrats sont de moins en moins anecdotiques et pourraient constituer à l’avenir une menace systémique. Qu’elles émanent de justiciables isolés, de réseaux criminels organisés ou de mobilisations politiques, elles visent toutes à influencer le cours de la justice ou manifester une désapprobation de la manière dont la justice est rendue. Mais le vrai enjeu démocratique est celui de la confiance perdue dans les institutions dont la justice est un pilier cardinal pour garantir la paix civile et la protection de ses représentants forces de l’ordre, greffiers, administration pénitentiaire, magistrats. C’est également dans les pays totalitaires ou corrompus que l’on cherche à museler les juges ou à influencer leurs décisions.
La protection des magistrats ne relève donc pas uniquement d’une question de sécurité individuelle, mais engage directement la capacité de l’État à garantir l’indépendance et la sérénité de l’institution judiciaire, conditions indispensables au maintien de l’État de droit. Les syndicats de magistrats sont souvent en première ligne pour signaler les incidents à la chancellerie : courriers menaçants, intimidations sur les réseaux sociaux, voire agressions physiques au tribunal ou au domicile des magistrats. Les réactions ne sont pas toujours à la hauteur de nos attentes. Pour autant on ne peut pas mettre sur le même plan toutes les violences : justiciables mécontents, délinquants multirécidivistes, militants radicaux ou encore proches de personnes condamnées. L’anonymat d’Internet amplifie sans doute le phénomène et la difficulté à évaluer la gravité de ces menaces.
Face à cette situation, plusieurs pistes sont à explorer. Le renforcement de la protection physique constitue une première réponse : sécurisation des palais de justice, installation de dispositifs anti-intrusion, attribution de moyens de protection individuels.
Sur le plan pénal, des sanctions aggravées sont prévues pour les violences ou menaces contre les magistrats. L’outrage à magistrat (article 434-24) est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Les violences contre un magistrat dans l’exercice de ses fonctions constituent une circonstance aggravante, alourdissant considérablement les peines encourues.
L’article 222-14-2 du Code pénal sanctionne spécifiquement les menaces de mort ou d’atteinte aux biens contre un magistrat, punissables de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans et 100 000 euros lorsque les menaces sont réitérées.
La sensibilisation du public au rôle de la justice et le renforcement de la communication institutionnelle doivent également viser à restaurer le respect de la fonction judiciaire en améliorant la pédagogie des décisions. Il serait également intéressant de réfléchir à une meilleure protection des données personnelles des magistrats et à un renforcement de leur formation face aux situations conflictuelles.
La France n’est pas un cas isolé et de nombreux pays européens connaissent des situations comparables. En Italie, les juges antimafias bénéficient depuis longtemps d’une protection rapprochée. En Espagne, les menaces contre les magistrats se sont multipliées ces dernières années. Le Procureur du roi à Bruxelles est nommément visé par le narcotrafic. Les États-Unis font face à une augmentation significative des menaces contre les juges fédéraux. Cette dimension internationale suggère des causes communes : crise de confiance envers les institutions, polarisation politique, influence des réseaux sociaux et montée des discours anti-élites que des mesures de protection ne suffiront pas seules à résoudre. Le malaise est plus profond et les conséquences pour l’État de droit peuvent être considérables. La violence contre les magistrats constitue une atteinte directe à l’indépendance de la justice, pilier fondamental de la démocratie. Un magistrat menacé peut subir des pressions affectant son impartialité ou l’amenant à l’autocensure moins visible mais tout aussi problématique.
Plus largement, ces violences sont aussi le signe de l’érosion de la confiance citoyenne dans l’institution judiciaire et banalisent les comportements agressifs envers l’autorité publique.
La protection des magistrats dépasse donc la simple question sécuritaire : elle engage la capacité de l’État à garantir une justice sereine et indépendante, condition sine qua non du fonctionnement démocratique.
Dans ce contexte l’État a une autre responsabilité importante, l’obligation fondamentale de protéger ses agents par le mécanisme de la protection statutaire spécifique ancrée dans plusieurs textes fondamentaux. L’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature garantit leur indépendance et leur inamovibilité. Cette protection vise à assurer l’exercice serein de la justice.
Cette protection fonctionnelle est également codifiée par la loi du 13 juillet 1983, qui impose à l’administration de protéger les magistrats contre les menaces, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont ils peuvent être victimes dans l’exercice de leurs fonctions. Cette protection inclut la prise en charge des frais d’avocat lorsqu’un magistrat est poursuivi ou attaqué en raison de ses décisions judiciaires, ainsi que la réparation intégrale des préjudices subis.
Concrètement, l’État doit mettre en œuvre des mesures de protection adaptées. Le ministère de la Justice dispose d’un service dédié à l’évaluation des menaces et à la mise en place de dispositifs de protection.
L’administration est également tenue d’exercer l’action publique ou de se porter partie civile lorsqu’un magistrat est victime d’une infraction en lien avec ses fonctions ce qui n’est pas toujours le cas. Cette protection ne peut être à géométrie variable selon les profils de magistrats ou la nature des dossiers traités. Il n’y a pas de petites violences ou de petits juges mais la nécessité d’une prise de conscience que la société a changé et que la justice doit s’adapter, mieux communiquer sur le sens de son action et mieux protéger ses agents de manière équitable et efficace.