Intégration du consentement dans l’incrimination des violences sexuelles : ce que cela va changer en pratique
La nouvelle rédaction de l’article 222-22 du Code pénal intègre désormais la notion de consentement dans la définition pénale du viol et de l’agression sexuelle. Que changera cette nouvelle définition des agressions sexuelles et du viol pour les personnes mises en cause, pour les victimes, pour les enquêteurs, pour les magistrats ? Les grands principes de la procédure pénale seront-ils préservés ?
Publié le | Modifié le
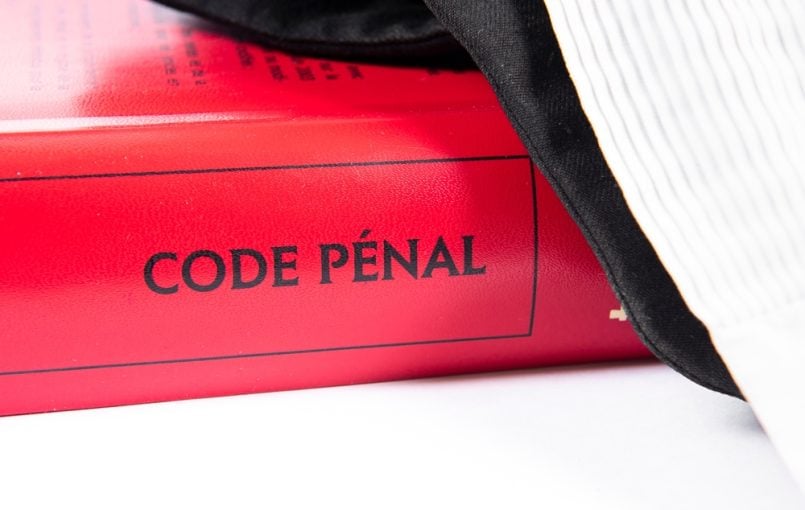
Par François Lavallière, Premier vice-président du Tribunal judiciaire de Rennes, coordinateur du pôle violences intrafamiliales et maître de conférences associé en droit pénal à Sciences Po Rennes.
Que va changer la loi pour les victimes et les mis en cause ?
La loi pose désormais un préalable obligatoire à tout contact sexuel : la vérification du consentement du ou de la partenaire. Le consentement ne pouvant pas être déduit « du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime », la formule si souvent entendue « elle n’a rien dit, elle ne s’est pas débattue, je pensais qu’elle était d’accord » n’aura plus d’incidence juridique pour écarter l’élément intentionnel de l’infraction. Au contraire, le simple fait ne pas avoir vérifié le consentement pourra entraîner condamnation car l’élément intentionnel sera caractérisé par cette abstention.
C’est le comportement de l’auteur qui sera étudié. A-t-il recueilli ou vérifié l’accord de son ou sa partenaire ? Comment l’a-t-il fait ? Lui offrait-il une liberté et une sécurité suffisantes pour qu’il ou elle puisse refuser ? Tel n’est pas le cas lorsqu’il fait usage de violence, menace, contrainte ou surprise par exemple.
Les qualificatifs retenus pour définir ce que doit être le consentement (libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable) sont suffisamment précis pour que les magistrats s’emparent aisément de ce nouveau texte. Un accord purement « formel », un oui « forcé » car contraint par une relation de domination, de pouvoir, de subordination pourra être écarté par les juges. En effet, dans ces « circonstances », le consentement ne sera pas considéré comme « libre ».
Un accord pour un acte sexuel particulier n’implique pas un accord pour un autre acte, par exemple accepter des caresses sur les parties intimes ne signifie pas que l’on est d’accord pour une pénétration, le consentement étant « éclairé et spécifique ».
Le consentement doit également être « préalable et révocable », il doit être vérifié avant le début de l’acte sexuel et peut être retiré à tout moment de celui-ci. Le droit de changer d’avis et le devoir de s’arrêter immédiatement s’appliqueront.
La victime ressentait souvent de la culpabilité, celle de ne pas avoir réussi à se débattre ou à s’opposer. Son absence de réaction pouvait avoir de multiples causes : la peur, le lien de subordination, la dépendance financière ou bien l’état de sidération notamment, cette dernière situation étant très fréquente, jusqu’à 70 % des cas de violences sexuelles. Avec cette nouvelle approche, la question ne sera plus de savoir pourquoi la victime ne s’est pas opposée mais comment la personne mise en cause a vérifié le consentement or une personne en état de sidération ne peut en aucun cas exprimer un consentement.
Que va changer la loi pour les enquêteurs et les magistrats ?
Les enquêteurs et les magistrats n’auront plus à rechercher si la victime s’est débattue ou opposée mais si la personne mise en cause a vérifié le consentement, de quelle manière et quelles vérifications elle a réalisées en l’absence de consentement exprimé verbalement.
Les questions posées par les enquêteurs et les magistrats aux mis en cause changeront : lui avez-vous demandé si elle était d’accord ? Comment l’avez-vous fait ? Que vous-a-t-elle dit précisément ? Dans l’hypothèse où le consentement n’aura pas été exprimé verbalement, la personne mise en cause sera interrogée sur les éléments sur lesquels elle s’est appuyée pour croire que son ou sa partenaire était d’accord. La jurisprudence canadienne a progressivement écarté les réponses qui révélaient que la personne s’était fondée sur des stéréotypes de genre, des « mythes ». Les juridictions françaises pourront à leur tour écarter ce qui reste équivoque et relève des déductions subjectives et sexistes : une femme qui a accepté de boire un verre, qui portait une tenue particulière, qui a suivi son partenaire dans un appartement n’a pas, par ces comportements, manifesté un quelconque consentement à un contact sexuel. De plus, avoir précédemment accepté un acte sexuel avec le mis en cause ou un autre partenaire sera sans incidence pour apprécier le consentement le jour concerné par les faits dénoncés. Cela pourra permettre de sortir du débat judiciaire les « pratiques habituelles » de la victime, élément stigmatisant souvent source de victimisation secondaire.
Il faudra également, lorsque l’accord formel aura été contraint, forcé par une relation de pouvoir ou de domination, démontrer la nature de cette relation, son impact, et la conscience par l’auteur du caractère déséquilibré de la relation. L’existence d’un contrôle coercitif pourra également être envisagé au titre des « circonstances » qui permettront de considérer comme non valable le consentement exprimé.
Pour les actes commis avec violence, menace, contrainte ou surprise, les critères posés par la jurisprudence actuelle continueront à s’appliquer.
Les grands principes de la procédure pénale vont-ils être préservés ?
Oui ! Il reviendra toujours au juge d’instruction et au procureur de la République de démontrer que la personne mise en cause n’a pas mis en œuvre les mesures raisonnables pour vérifier le consentement de son ou sa partenaire, ou a obtenu un consentement dans des circonstances où il ne peut être considéré valable, ou a fait usage de violence, menace, contrainte ou surprise.
Il n’y a aura pas d’atteinte à la présomption d’innocence car lorsqu’il existera in fine un doute, le mis en cause ne pourra être condamné.
La nouvelle définition des agression sexuelles et du viol implique un tel changement de paradigme que tous les professionnels de la chaîne pénale devront être formés spécifiquement. C’est l’une des conditions nécessaires pour atteindre les objectifs de cette loi. L’enjeu social le justifie et cela permettra aux victimes de retrouver confiance en la Justice.


