Arrêt maladie et report des congés payés : une jurisprudence européenne critiquable
Les salariés français ont désormais la possibilité de reporter leurs congés payés s’ils tombent malades pendant leurs vacances. Le temps de congés payés est également désormais pris en considération pour le calcul hebdomadaire des heures supplémentaires majorées. Ces droits découlent de deux décisions récentes de la Cour de cassation visant à « mettre le droit français en conformité avec le droit européen ».
Publié le | Modifié le
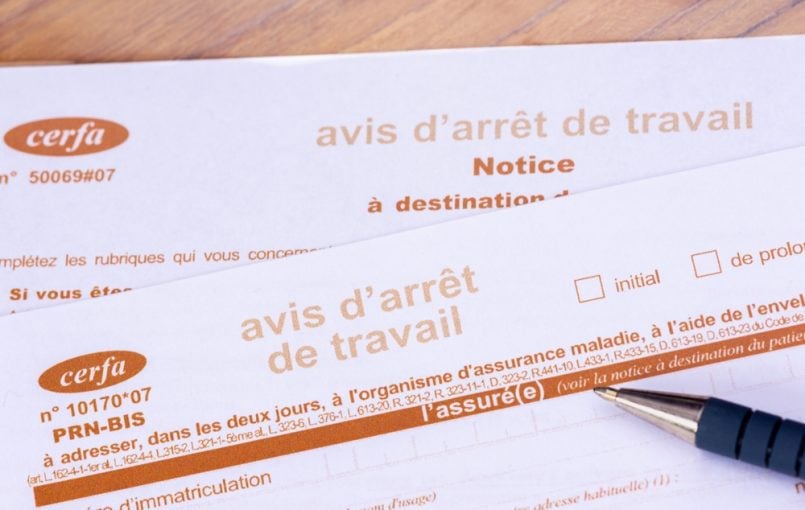
Par Franck Morel, Avocat associé chez Flichy Grangé Avocats
Qu’a décidé la Cour de cassation ?
Voici quelques jours, la Cour de cassation a rendu deux nouveaux arrêts concernant les congés payés visant, selon son communiqué, à mettre le droit français en conformité avec le droit européen. Dans le premier arrêt (Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-22.732 FP-B+R), le juge précise qu’un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés, et qui a notifié à son employeur son arrêt maladie, a le droit de voir ses congés payés reportés. Dans le second arrêt (Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-14-455 FP-B+R), il indique que lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, les jours de congés payés sont pris en compte dans l’assiette de calcul hebdomadaire des heures supplémentaires.
Ces deux arrêts illustrent un emballement de la machine judiciaire européenne à produire des évolutions du droit contestables sans qu’on puisse véritablement l’arrêter. Aux origines était la directive sur le temps de travail 2003/88/CE du 4 novembre 2003, datant en réalité du 23 novembre 1993, qui dispose que « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. » Il est également précisé dans cette directive que la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. Et c’est tout sur le sujet des congés payés.
Comment en est-on arrivé là alors ?
C’est une construction jurisprudentielle de la Cour de justice de l’Union européenne amorcée dès l’arrêt BECTU du 26 juin 2001 (aff. C-173/99) en vertu duquel il était impossible de subordonner le droit à congés payés à une période minimale de travail en passant notamment par les arrêts Schultz-Hoff du 20 janvier 2009 (aff. C-350/06) et Dominguez du 24 janvier 2012 (aff. C-282/10) qui garantissaient le droit à report des congés payés en cas de maladie et d’acquisition de congés payés même en période de maladie. Pour le juge européen, le droit à congé annuel payé de chaque travailleur constitue un principe du droit social de l’Union européenne revêtant une importance particulière auquel il ne saurait être dérogé. Mais surtout plus encore, il estime que la finalité du droit au congé annuel payé qui est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs diffère de celle du droit au congé de maladie qui est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie.
Notre droit positif national ne conduisait pas à prendre en compte de manière générale ces règles. Pendant longtemps, le juge national a résisté au nom du fait que l’effet des directives n’est qu’horizontal. En effet, leur contenu n’est opposable qu’aux Etats et non aux litiges entre personnes privées (notamment CJCE, 14 juillet 1994, aff. C-91/92).
La responsabilité de l’Etat pour défaut de transposition d’une directive pouvait néanmoins être engagée et elle le fût (TA Clermont-Ferrand, 1ère ch. 6 avril 2016, n°1500608). Il faut déjà souligner que l’Etat pouvait donc être condamné en réalité non pas pour défaut de transposition d’une directive mais bien pour défaut de transposition d’une jurisprudence européenne rendue sur le fondement de ladite directive.
Puis, le juge européen considéra, dans l’affaire Bauer, que l’article 31 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne, partie intégrante des Traités européens depuis 2009 et disposant que tout travailleur a droit à une période annuelle de congés payés, était d’application directe aux litiges entre particuliers et fondait donc l’application directe de ces principes (CJUE, 6 novembre 2018, aff. C-570/16).
Dès lors, le juge national était lié et a dû céder (cass. soc. 13 septembre 2023, n°22-17340) et le législateur a dû faire évoluer le droit pour réduire l’impact autant que possible de ces changements (art. 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dite loi « DDADUE »).
Le revirement jurisprudentiel du premier arrêt ne constitue donc que la suite logique de ce processus, inévitable. La Commission européenne avait mis en demeure la France de mettre son droit national en conformité sur ce point et cet arrêt y répond. On pourrait aussi rappeler que cela a été fait par la loi portant DDADUE évoquée précédemment puisque, depuis ce texte, tout salarié qui est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, bénéficie d’une période de report. Cela vise donc bien ces situations. Il faudra cependant être vigilant sur la notification des arrêts maladie.
Le second arrêt écarte, en outre, partiellement une disposition du Code du travail sur les heures supplémentaires et procède du même mécanisme et d’une jurisprudence européenne tout aussi contestable. Le juge européen avait ainsi analysé, dans l’arrêt Koch du 13 janvier 2022 (aff. C-514/20), un mécanisme classique en vertu duquel un temps de congé payé durant une semaine n’était pas comptabilisé comme un temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires. Il avait jugé à cette occasion que ce mécanisme était susceptible d’entraîner une réduction de la rémunération du travailleur, celle-ci étant amputée de la majoration pour les heures supplémentaires accomplies, et qu’il était de nature à dissuader le travailleur d’exercer son droit à congé annuel, le juge devant veiller à l’effet utile de ce droit. Il fallait donc considérer le temps de congé payé comme du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires et de l’octroi des majorations de salaires qui en découlent.
Les arrêts de la Cour de cassation sont donc malheureusement logiques comme l’impossibilité pour le législateur national de ne pas en tenir compte. Ce qui est éminemment critiquable, c’est la position du juge européen.
En effet, le caractère laconique de l’expression du droit du tout travailleur de disposer d’une période annuelle de congé payé rend totalement discutable la construction qui amène sur la base d’un raisonnement sur la finalité du congé payé à la solution juridique retenue.
Plus encore, le fondement de la directive qui est uniquement la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (article 153 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et le fait que la rémunération ne fait pas partie des compétences de l’Union européenne rend également contestable la position sur les heures supplémentaires.
Pourquoi le juge européen n’est-il pas astreint à une étude d’impact lorsque des arrêts ont, comme c’est le cas ici, un impact assez considérable sur le droit national ?
Pourquoi ne pourrait-on envisager de revisiter le principe de subsidiarité prévu aux articles 5 et 10 du Traité de l’Union européenne ? Selon ce principe, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens. Le juge européen l’oublie un peu. On pourrait promouvoir une nouvelle méthode tendant à identifier des droits essentiels d’ordre public et permettant sur le reste d’apprécier la conformité du droit national au droit européen de manière globale, le caractère avancé des droits sociaux dans un domaine pouvant compenser l’insuffisance des règles dans un autre domaine. Nous disposons dans notre droit de cinq semaines de congés payés et non des quatre minimales requises et cela pourrait fonder, dans un tel cas, une règle différente sur la question de la maladie et des heures supplémentaires.


